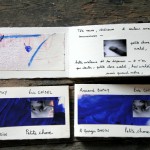André Eulry : du refus à l’amour, une « inquiétude intrépide »
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder ils s’habitueront. » (Char)
Il lisait à haute voix les exigences du poète, s’arrêtait aux impératifs vivants au début de chaque proposition, ce qui le menait à des lieux de ciel et de terre, de mousse et d’écorce, de branches et de feuilles, de cailloux et d’eau en marche. Il ajoutait l’aube et ses débuts : le bleu en permanence, le jaune venant de la mer. Il savait, ce poète-peintre, qu’elle ne disparaîtrait pas, cette lumière, puisque chaque matin elle serait de retour, face à lui et dans ses toiles. André qui a déjà agi dans sa lecture du poète est placé devant cette profusion. Le chemin qu’il emprunte, jaune et bordé d’herbes vertes, odorantes, avec à droite des pierres et des feuilles qui sont des voûtes, atteint la rayure bleue du ciel, inscrite sur les toiles déjà presque réalisées.
Modèles : à quel moment ce mot qui veut des éparpillements était-il né pour lui ? Très tôt le matin il l’évitait. Seule cette attente semblait faire surgir une cohérence, de même nature, de même couleur qu’à la fin du jour. André à la rivière avait un seul repère et s’il restait passif le modèle qu’il avait devant lui, l’assaillant, l’égarait en quelque sorte par un réalisme naïf. Chez lui, dans cette maison ouverte sur les arbres et sur les montagnes du matin, revenaient aussi d’autres modèles : Hélène la pourvoyeuse et les enfants qui l’accompagnaient. Troubles et présences mêlés lorsque le désir était si fort , celui surtout de ne pas s’arrêter, de ne pas s’attribuer une victoire pourtant approchée mais remise devant soi comme une pierre jetée. Copier, ce verbe inactif, lui était étranger. Il ne voulait pas, devant le surgissement du « grand réel »un résumé, une perte sans retour, une explication vaine mais plutôt ce que j’entendais ou voyais sur ces peintures, c’était : approches, épanchements, sensation – bienfaisante – d’être cerné, continuer pour ne pas se perdre, ne pas éviter les manques, mais les détourner. Je savais que j’ajouterais d’autres mots qu’il me donnerait.
Souvent quand je croisais André, une multitude de personnes se pressaient à son écoute – le savait-il ? J’étais toujours prêt à l’entendre converser avec les autres, tant l’envie qui le poussait à les regarder agir, était sa seule pensée et on songeait à un passé religieux et au désir de rivaliser avec Dieu, sans peur et sans bouclier, sinon de s’approcher du Créateur, peut-être même d’avoir aussi son chemin de croix et des haltes dans les jardins des oliviers.
Si Char a employé le verbe « s’habituer », c’est qu’il évoque à chaque rencontre un temps très court, donc il interroge incessamment. André Eulry vivait ainsi les choses.
« Le peintre apporte son corps » (Paul Valéry). A partir de cet énoncé à compléter, qui peut recevoir les suggestions, les formes malléables, et s’il y a une ébauche de corps dans le lointain, est-ce le corps de celui qui a dessiné dont on distingue difficilement les détails, ou si le peintre est penché sur l’eau, on ne sait pas si c’est son propre corps qu’il interprète, qu’il fait varier. Je me souviens d’une peinture de 2 ou 3 cm qu’Eulry m’avait donnée et je lui avais dit sa grandeur : les deux formes de couleur – jaune et rouge – se faisaient face, semblables en cela à la voix de la chanteuse et du violoncelle qui la suit sans jamais la rejoindre chez Bach. J’ai su que le regard que le peintre posait sur les choses, par exemple le tronc du chêne-liège, rouge sans liège, rejoignait les corps qu’il aimait pour ne pas s’arrêter de dire où il était, ce qu’il faisait, pourquoi il s’exposait.
« Le don de plaire » cher à Baudelaire ne le quittait pas même s’il n’était pas en train de travailler, rejoignant Braque lorsque celui-ci s’inquiétait de la perte de l’ardeur au profit du talent. L’ardeur suppose un feu qui ne décline pas, ce serait aussi être regardé, être lu, presque être aimé, le talent ne serait qu’une bouée de sauvage sans efficacité.
L’attente, l’oubli, l’une comme l’autre participent à un état avec ses durées, ses soubresauts, ses arrêts. On pourrait improviser. Ce qui se voyait chez le peintre, c’est qu’il était maître de ses attentes, des oublis imprévisibles, dispositions qui pouvaient se lire quand il vous disait : je vais à la rivière ou je suis dans mon atelier. C’était du temps dont les angles étaient divers mais on savait qu’il en résulterait des notes et souvent même des toiles inattendues. L’attente : son alliée. L’oubli : sa défense.
Il allait souvent à la rivière, à quelques kilomètres de chez lui, toujours la même, appelée la Passagère. La main à la portée des couleurs. Chassant toute pensée sans obstination. Il suffisait qu’il se penchât sur l’eau et ses mouvements pour tracer déjà le rectangle. L’écart entre le sable et la brindille de bois sur le carnet était immobile, faisait seul le lien entre sa vision et son dessin. J’entendais les phrases qu’il me disait : « J’aime ces moments-là où le sujet m’est donné, et plus tard à chaque retour il me fuit, il déserte, seul demeure ce qui a été désirable. »
Il reste souvent, des jours durant, dans un temps indécis, dont la lenteur ne se laisse pas mesurer et s’il se souvient du poème de Baudelaire l’Heautontimoroumenos, il se trouve, selon les paroles propres à l’Opinion, plus que victime, dépossédé de tout zèle, d’initiatives tandis que sur l’autre face qui lui apparaît plus douce, il est celui qui agit. Un jésuite civil, se disant peintre, affirme qu’il ferait mieux de s’occuper de ses enfants et chaque fois qu’il rencontre André, il ne le questionne pas sur ses jours de peinture, ses heures de dessin, alors qu’il va répétant qu’on reconnaît de loin ses propres toiles noires, comme une robe maternelle qu’il revêt avec des yeux ressemblant étrangement à sa mère la plus familière, la plus proche, la moins disparue.
« Les jours s’en vont, je demeure ». De là on peut ajouter ce conseil qui donne du courage : « Ne t’attache pas à l’ornière des résultats ». Deux poètes se rencontrent dans le langage et s’opposent à toute soumission. En effet il y a des certitudes lorsqu’on parle qui ne sont vraies que lorsqu’on les reprend dans l’écriture. André savait cela lorsqu’il parlait bruyamment à d’autres, après s’être assis face à la personne qui le suivra peut-être sans répondre, subjuguée qu’elle sera par cette volonté de persuasion qu’il sait pourtant éphémère. Dispersion de paroles contre un ordre qui n’était plus le sien. Dira-t-on que cette parole éparpillée lui donnait autant de vues, de sentiers pour son aventure de peinture ?
Six morceaux de piano courts que Beethoven intitule « Bagatelles », des quatuors à cordes, des sonates, Bach très souvent. Le visage est attentif, les yeux semblent dirigés vers une ouverture bleue, que les rideaux de l’atelier adoucissent. Je pense alors à un mot qui me traverse, éclaire et sûrement l’éclaire : la dette envers ces maîtres qu’il ne peut saisir mais qui le porte au moment même où il les écoute .
Avait-il accès aux traits d’union unissant peinture et monde, elle et lui si peu distants ? Et s’il y avait un écart qui pourrait être dit entre eux, il lui fallait attendre pour qu’ils soient face à face sans animosité, ne pouvant pas jouer avec les bras comme le chef d’orchestre, si juste pourtant avec ses courbes, ses aplats, ses élévations, ses silences.
Que disaient les feuilles du peuplier jaunies dans le luisant du vert ? Sûrement elles proposaient à l’eau au pied de l’arbre que la couleur ne disparaisse pas sur l’eau bleue.
« Oui, dit-il, je te nomme, hésitation/ Qu’a eue ce martinet prenant son vol, / Qu’a-t-il vu qui le tint comme suspendu/ Un instant dans le cri de tous les autres ? Je veux te dénommer pour me souvenir. » (Yves Bonnefoy, Raturer outre).
Si peu de matière à la portée du peintre, qu’il ne peut pas l’éparpiller : ‘elle se dissoudrait disparaîtrait. Mais elle rejoint le martinet du poète et l’eau de la rivière sur laquelle le peintre se penche pour nommer sur le papier les brindilles et les pierres qui se font face, pour finalement se nommer et laisser leur part de mystère à l’intention de ceux qui regarderont. Le peintre aurait souvent dit « hésitation » sans qu’on l’entende mais elle se voyait dans le temps, comme suspendu, des instants qu’il invitait à voir, à entendre, à comprendre, à aimer.
S’il foulait aux pieds les usages de la politesse, chaque jour, le glaive qui la transperçait était son rire haut et le regard qu’il portait ensuite sur les copies déjà corrigées des élèves, posées sur la grande table, disait : c’est pour les enfants, domaine du secret.
Les bien-pensants, si peu courageux sans jamais être bienveillants, lui faisaient tourner le dos. Alors que le jour se levait à peine , deux couleurs l’attiraient, le jaune et le bleu, le premier de source éphémère, le deuxième qui l’emporterait comme le rire des enfants quand ils s’éveillent.
Je ne tiens pas André prisonnier dans « Je ne suis qu’un cri » , la chanson de Ferrat. Et pourtant il se serait arrêté, ému peut-être par elle, ne rejetant pas cette lueur vite éteinte, je savais bien que ce à quoi il croyait chaque jour faisait de sa sensibilité « une amorce et un bouclier « . Mais non, un bouclier, sûrement pas : il aimait trop être à découvert, même face à l’ennemi qui broyait du noir dans sa vie et dans son « œuvre » comme il disait sans raison
Cette franchise (une générosité aussi) que la rareté secourait, affermissait par cette lumière dont le mot revenait souvent dans nos conversations, alors que je la plaçais semblable à celle de Madeleine qui veillait de Georges de la Tour, rendait le visage hors du temps, cette franchise ne se perdait pas dans ses peintures.
Sa rare franchise (sa générosité aussi) lui donnait vigueur et force, ne se perdait pas dans sa peinture et cette lumière – le mot revenait souvent dans nos propos – que je rapprochais de celle de Madeleine qui veillait de Georges de la Tour, plaçait son visage hors du temps.
Il avait tout au début de son séjour à Céret un assaillant, petit homme à la vie minuscule avec ces mots : « Il ferait mieux de s’occuper de ses enfants. » Il fut atteint par ce mal sans courage mais vite il ne pensa plus à ce stéréotype.
« Je ne suis que moi-même » écrit Romain Gary. Et s’il voulait sortir de lui, après de petits calculs, l’assaillant d’André marchait d’un pas mesuré, parcourait à la même heure en fin d’après-midi le boulevard, avait cette figure impassible qui attendait l’approbation sans que cela parût et avant de tremper son pinceau dans le noir pour que se perde la blancheur de la toile, il savait déjà à qui la montrer : un alter ego qui l’approuverait. André n’était pas dans ces ruses. Il disait : ça va finir et s’il était alors dans l’inachèvement, il multipliait les dessins sur des feuilles aux formats variés pour compléter toujours ce manque, cette perte qu’il remarquait dans chacun d’eux.
De « nouveaux arrivants », nombreux, vont sortir de l’ombre le travail d’André Eulry avec le désir de retenir l’éclat par le regard, sans toutefois parvenir à la possession – peintures, dessins tenus vivants dans « la chaleur vacante » du poète André du Bouchet.
Georges Badin